Un vadrouilleur émancipé
Franck Taillandier
Chercheur en aide à la décision dans le laboratoire RECOVER, Franck Taillandier a beaucoup vadrouillé et porté plusieurs casquettes. Désormais installé dans le Var en pleine nature, il poursuit ses travaux et n’arrête jamais d’apprendre. Au fil des projets communs auxquels il participe, il fait dialoguer sans cesse des domaines de recherche variés.
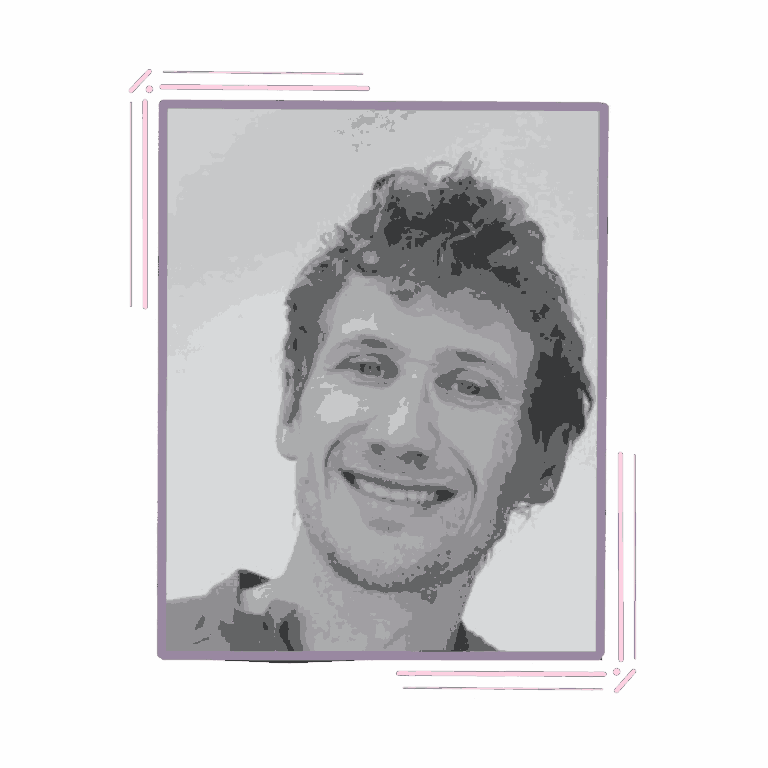
Des rencontres et des choix
Comme beaucoup d’entre nous, le parcours de Franck Taillandier est le fruit de remises en question régulières et de relations humaines jouant à certains moment-clés de la vie. « J’ai fait une prépa Math sup / Math spé, puisque mon père et mon grand frère avaient fait ça aussi », raconte-t-il. La suite est elle aussi l’illustration d’une reproduction sociale, avec ses trois ans passés à l’École spéciale des travaux publics de Paris, « la même que celle de mon père ». Dès sa deuxième année, il réfléchit à la suite qu’il pourrait donner à ses études car il ne se projette pas dans un parcours d’ingénieur en génie civil.
Le chercheur passe donc son agrégation à Toulouse. Grâce à des discussions avec un camarade de promotion, il part pour Chambéry intégrer une autre école d’ingénieurs plus axée sur le développement durable. « C’est là que je me suis initié à l’aide à la décision », relate-t-il. S’en est suivi une thèse sur la gestion d’un parc immobilier, avec un accent mis sur la gestion du risque. Bien qu’il n’y ait pas de chercheur dans sa famille, il est inspiré par son frère jumeau et un ami d’enfance très proche, tous deux en thèse. « Dans cet environnement proche, il y a eu une émulation qui nous a motivés », conclut-il.
Son nouveau diplôme en poche, Franck travaille en post-doctorat au Canada pendant un an. « J’ai appris plein de choses là-bas et ça s’est super bien passé, y compris humainement » se remémore-t-il. Il est ensuite venu dispenser des cours de génie civil en tant qu’enseignant-chercheur à l’université de Bordeaux entre 2010 et 2019. Quelques temps avant son départ pour Aix-en-Provence puis dans le Var, il dépose auprès de l’Agence nationale de la recherche son dernier projet de recherche à ce jour en tant que coordinateur : SwITCh. Celui-ci consiste à proposer des outils d’aide à la réflexion sur la mobilité urbaine et son devenir, selon une approche prospectiviste.
« C’est un cadre préservé et très protégé »
« On avait envie de changer un peu d’environnement, explique Franck, moi je me sens potentiellement bien partout, […] mais ma femme est vraiment de la campagne, les trop grandes villes, elle n’aime pas trop. » Son nouveau cadre de vie dans le Var lui plaît beaucoup, tout comme son nouveau poste. Il dépeint un lieu de travail idyllique : « L’INRAE est juste à côté d’Aix-en-Provence, au pied de la Sainte-Victoire [montagne, ndlr] ; c’est vraiment un paysage magnifique. »
Sa maison, entièrement autonome grâce à des panneaux solaires, s’inscrit elle aussi dans ce nouveau mode de vie. « On a fait un choix radical, […] on est isolés, reliés à aucun réseau et entourés par la forêt » décrit-il. Mais ce genre de choix implique également d’autres contraintes qui peuvent paraître contradictoires. « Moi, je pratique la voiture bien malgré moi puisque je vis isolé, déplore-t-il, mais je pratique aussi le vélo, […] je le mets dans mon coffre pour finir mes trajets avec. »
La pluridisciplinarité comme philosophie de recherche
Si l’intermodalité des modes de transport reste un défi complexe sur un territoire à la présence humaine morcelée, les environnements urbains sur lesquels travaille Franck y semblent plus propices, du moins en apparence. Des incidents continuent de se produire, comme en témoigne la mort d’un cycliste de 27 ans à Paris, en octobre dernier. « Ce cas précis était vraiment violent, explique-t-il, hormis ces cas exceptionnels, on peut s’intéresser […] à tous les accrochages ordinaires dans la vie de tous les jours. » Les pistes d’amélioration pour faire évoluer les comportements et faciliter les moyens de transports légers sont très variées : infrastructures, réglementation spécifique, valorisation et reproduction sociale, acculturation par l’usage etc.
« Les comportements, c’est un sujet que je ne connaissais pas tant que ça, je connaissais plus le côté infrastructures », confie le chercheur. Aussi, il est convaincu des bienfaits de la pluridisciplinarité pour évoluer et apprendre sans cesse. « C’est quelque chose de très motivant, […] de se remettre en question en tant que chercheur, en tant que citoyen. » détaille-t-il. Les échanges entre les disciplines sont ainsi au cœur de ses travaux et sa philosophie de travail. Franck recherche également ces qualités chez les doctorant·e·s qu’il encadre : « Les meilleures thèses que j’ai eues, ce sont des personnes qui ont pu embrasser ça complètement. »

Franck Taillandier s’est lancé dans la recherche avec une vision préconçue. Il raconte : « Comme beaucoup de gens, je pensais qu’il fallait être extrêmement intelligent pour être chercheur. Et en fait, ce n’est pas du tout une image fidèle à la réalité. On n’est pas tous Einstein, et il n’y a pas besoin de l’être, heureusement ! » Voilà une bonne occasion de le redire : les théories scientifiques ne sortent pas du seul cerveau d’un génie une fois par siècle. Elles trouvent leur origine dans un travail collaboratif et collégial au long court.
Écrit par Maxime Flouriot
